DES QUESTIONS MINISTERIELLES - DES REPONSES TARDIVES – UNE SITUATION QUI STAGNE
Il est toujours intéressant de rappeler aux dirigeants leurs propos et leurs promesses… !
Recherchant des éléments concrets sur la « sacro-sainte » querelle entre continuité écologique et développement de la petite hydroélectricité, j’ai retrouvé dans des annales relativement récentes, deux questions ministérielles posées par des élus des Pyrénées-Atlantiques (Monsieur Max BRISSON) le 17 juillet 2022 pour la première et de l’Indre (Monsieur Nicolas FORISSIER) le 4 avril 2023 pour la seconde.
Il aura fallu six mois minimum d’attente à ces deux députés pour être gratifiés d’une réponse du ministère. Force est de constater que sur le terrain, en ce qui concerne les propriétaires et porteurs de projets, très peu de progrès ont été faits !
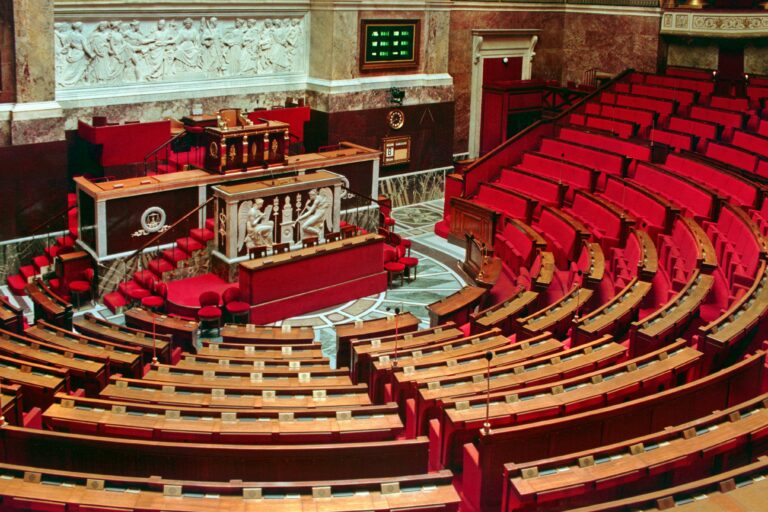
qUESTION DE MONSIEUR BRISSON (extraits)
Il Il attirait l’attention du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la politique appliquée de destruction des retenues d’eau et l’avenir des moulins français.
Il rappelait que l’article L. 214-17 du code de l’environnement prévoit exclusivement « la gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages de retenue d’eau dans le cadre de la circulation piscicole et sédimentaire.
Pourtant, depuis plusieurs années, une politique de destruction des ouvrages de retenue d’eau était appliquée, bafouant la lettre et l’esprit de la loi et affectant lourdement la préservation de la ressource en eau.
Entreprise massivement depuis 2015, la politique de destruction était justifiées par les conséquences néfastes des ouvrages de retenues d’eau sur les populations piscicoles, la qualité des eaux ou le transport des sédiments. Néanmoins, les chiffres qui ressortaient des évaluations des effets de cette politique ne correspondaient pas aux éléments motivant la destruction des ouvrages de retenues d’eau.
De plus, les petites retenues de moulins ne bloquaient pas le passage des sédiments.
En effet, 90 % des moulins français présentent des hauteurs de chute de moins de 2 mètres et des retenues qui se trouvent totalement noyées à l’occasion des petites crues, ayant lieu presque chaque année en saison hivernale. Par conséquent, les sédiments transitent sans difficulté à l’occasion des crues et de l’ouverture des vannages.
De surcroît, ces ouvrages de retenue d’eau réalisent un processus de dénitrification et leur destruction a pour effet d’augmenter les taux de concentration en nitrates et dérivés des eaux des rivières, dégradant nécessairement leur qualité physico-chimique, qui est pourtant un objectif de la directive-cadre de 2000 sur l’eau.
réponse du ministère publiée le 9 mars 2023 (extraits)
« La biodiversité aquatique est particulièrement fragilisée en France : 39 % des poissons sont menacés, et 19 % présentent un risque de disparition. Le défaut de continuité des cours d’eau fait partie des principale pressions responsable du déclin des poissons migrateurs.
Dans ce contexte, le Gouvernement réaffirme l’importance de la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. La stratégie biodiversité 2030 de la Commission européenne en fait également un enjeu majeur, qui apparaît aussi dans sa proposition de règlement pour la restauration de la nature. La politique de restauration de la continuité écologique concilie les enjeux de restauration des fonctionnalités des cours d’eau avec le déploiement de la petite hydroélectricité, la préservation du patrimoine culturel et historique, ou encore les activités sportives en eaux vives.
Depuis 2012, environ 1 400 effacements d’ouvrages, ont été financés par les Agences de l’eau sur les 11% de cours d’eau identifiés, soit 28 % des ouvrages à traiter, soit 1 % de l’ensemble des ouvrages obstacles à l’écoulement des cours d’eau français.
De nombreuses études et publications scientifiques démontrent l’intérêt d’effacer des petits ouvrages en cours d’eau, tant pour la survie et la reproduction des poissons migrateurs que pour l’amélioration générale des fonctionnalités la rivière, de sa biodiversité et de la qualité de son eau.
Le conseil scientifique de l’OFB a produit une note exposant des « éléments de réponse à certains arguments contradictoires sur le bien-fondé du maintien et de la restauration de la continuité écologique dans les cours d’eau » (2018).
Il est vrai que des petits ouvrages en rivière peuvent contribuer à maintenir une ligne d’eau plus haute, ce qui entretient l’illusion d’une eau disponible, mais tend à masquer le dysfonctionnement structurel et la gravité de la sécheresse en cours. La politique de restauration de la continuité écologique n’a pas entravé le développement de la petite hydroélectricité, qui a progressé significativement au cours des dernières années (plus de 150 MW supplémentaires entre 2018 et 2021), et n’est limité que par le faible potentiel restant. Selon les projets identifiés auprès de la filière, ce sont 250 MW qui pourraient être installés d’ici 2028 (en sites vierges comme sur les ouvrages existants), toutes tailles d’installations confondues.
Le développement de la petite hydroélectricité doit être efficace, réaliste et planifié, en cohérence avec la nécessité de préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques fonctionnels, indispensables à l’adaptation au changement climatique. À cette fin, le ministère encourage la concertation locale sur ces sujets hydroélectricités et milieux, pour rechercher les solutions les plus pragmatiques aux situations de blocage. Pour les cas ne trouvant pas de solution satisfaisante à ce niveau, l’intervention d’un médiateur national de l’hydroélectricité est rendue possible par le décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 instituant une expérimentation de médiateur de l’hydroélectricité, dont l’arrêté de nomination a été publié le 20 décembre 2022. »
Aujourd’hui en 2025, nous savons toutefois que la situation sur le terrain et dans le cadre des instructions de demandes est toujours très difficile.
Si le ministre a effectivement encouragé à la concertation locale…force est de constater qu’il n’a pas été entendu par ses services et que ceux-ci adoptent des lectures très différentes des exigences prescrites par la loi et les règlements !
Aucune harmonisation n’existe entre ces services au plan national alors que la règle devrait être la même pour tous !
L’instruction est trop souvent bloquée pour des exigences liées à la continuité écologique et la protection…excessive des milieux sans que le médiateur de l’hydroélectricité nommé à titre expérimental et étendu aujourd’hui à tout le territoire national puisse véritablement constituer un recours et une aide sérieuse pour les porteurs de projets.
question de monsieur forissier (extraits)
Ce député appelait à l’époque l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l’abrogation de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement mettant fin à l’exonération des moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Il attirait l’attention du ministre sur la préservation du patrimoine hydraulique et de la production d’énergie hydroélectrique permise par les moulins, contribuant au développement des énergies renouvelables.
Avec 4 grammes équivalents CO2 par kWh produit, il rappelait que l’énergie hydraulique représentait le meilleur bilan de toutes les énergies productrices d’électricité (GIEC IPCC, SRREN rapport 2012). De ce fait, même si la restauration de la continuité écologique des cours d’eau était une composante essentielle de l’atteinte du bon état des masses d’eau conformément à la directive cadre sur l’eau, sa conciliation avec les enjeux patrimoniaux et énergétiques, permettant la production d’une énergie bas-carbone, apparaissait essentielle face aux crises énergétiques et climatiques auxquelles nous devions faire face.
Il souhaitait donc savoir ce que le Gouvernement entendait mettre en place afin d’accompagner les propriétaires de moulins, les tiers délégués et les collectivités territoriales pour faciliter leur mise en conformité aux règles définies par l’autorité administrative mentionnée au 2° du I de l’article L. 214-17.
Il insistait sur le fait que la préservation de la biodiversité ne devait pas occulter les enjeux d’autoconsommation d’électricité ou de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
réponse du ministère publiée le 17 octobre 2023 (extraits)
e ministre reprend en partie la réponse faite en mars 2023 à Monsieur le député BRISSON en « assénant » que la biodiversité aquatique était particulièrement fragilisée en France…et que la fragmentation des cours d’eau faisait partie des principales pressions responsables du déclin des poissons migrateurs.
Il indique que la stratégie biodiversité 2030 de la Commission européenne en fait également un enjeu majeur, qui apparaît aussi dans sa proposition de règlement pour la restauration de la nature. La politique de restauration de la continuité écologique concilie les enjeux de restauration des fonctionnalités des cours d’eau avec le déploiement de la petite hydroélectricité, la préservation du patrimoine culturel et historique, ou encore les activités sportives en eaux vives.
À ce jour, la politique de priorisation mise en œuvre par le Gouvernement a permis d’identifier les cours d’eau sur lesquels il était important de procéder à de la restauration écologique. Ils représentent 11 % des cours d’eau. Sur ceux-là, la politique est de procéder prioritairement à des interventions sur environ 5 000 ouvrages sur les 25 000 obstacles à l’écoulement qu’ils comptent.
La solution technique retenue consiste majoritairement à aménager l’ouvrage (mise en place d’une passe à poisson, d’une rivière de contournement, abaissement du seuil…), plutôt qu’à le supprimer. Depuis 2012, environ 1 400 effacements d’ouvrages ont été financés par les agences de l’eau sur ces 11% de cours d’eau, soit seulement 1 % de l’ensemble des ouvrages obstacles à l’écoulement des cours d’eau français.
La suite de la réponse ministérielle est identique au mot près à celle fournie à Monsieur BRISSON en rappelant que le développement de la petite hydroélectricité devait être efficace, réaliste et planifié, en cohérence avec la nécessité de préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques fonctionnels, indispensables à l’adaptation au changement climatique.
Encore une fois…le ministère encourage la concertation locale sur ces sujets hydroélectricité et milieux, pour rechercher les solutions les plus pragmatiques aux situations de blocage, rappelant la possible intervention d’un médiateur de l’hydroélectricité dont nous n’avons pas vu concrètement, au sein de la profession, d’interventions significatives !
Petite hydroélectricité…à quand donc un développement efficace, réaliste et planifié effectif ?
Peut-être lorsqu’enfin, une véritable volonté politique existera !


